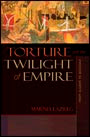Entretien avec le professeur Y
Façon maître
Un entretien pour expliquer quoi? Son style? Qui il était? Dans les premières lignes du texte, Céline est très clair là-dessus; son éditeur lui reproche de ne pas jouer le jeu. On lui demande de faire un geste. Il se creuse la tête pour faire plaisir à son "mécène"… mais après un rapide état des lieux, il se juge “ni écoutable, ni regardable”. Une sale gueule. La télé, la radio, c’est pour “l’écrivain génial Illisy” et le “rasoir sans lame Gatouillat”. Que faire ? Il ne lui reste guère que le vieux truc de l’interview. Avec ça, il sauve les meubles. Ce livre est donc une réclame, si l’on en croit son auteur. Une vraie danse du ventre. Et comme toujours avec Céline, on en a pour son argent. Jusqu’à la nausée...
Une synécure...
Mais avant le tout premier déhanchement, il faut trouver un musicien. Les candidats interviewers pouvaient se compter sur les doigts de la main. A l’en croire, ils se débinaient tous. Les plus prestigieux, « l’état major de Gaston », étaient en vacances ou prenaient les eaux... Injoingnables... Les autres en faisaient dans leur froc : « ils me posaient une condition : que je les mouille pas !... que je les cite pas ! ils acceptaient, mais « anonymes » !... ». Une cinquantaine au total ! Que des demi-secs. Alors il se décide : « j’en trouvai un, ça valait mieux, qui m’était tout à fait hostile... sournois et méfiant... » : le professeur Y.
Quant à l’histoire littéraire officielle (les entretiens sont publiés en 1955), elle parle de ses fiascos répétés après son retour d’exil. Déjà, avant-guerre, Mort à crédit, n’avait pas vendu comme on avait espéré… Dans les années 1950 les autres publications n’allaient pas fort non plus; l’ombre des pamphlets… Il aurait écrit ce livre pour relancer l’intérêt, les ventes…
Mais rions un peu... Céline sur un banc de square –le professeur Y n’a pas voulu le voir ailleurs- suppute déjà ; insulte son hôte, assez empoté. « le professeur Y, certainement, avait aussi son petit pensum qui attendait depuis des années dans les caves de la N.R.F. ». Il le cuisine. Allez ! Secouez-vous ! Posez une question ! « Vous allez voir le Gaston, s’il va valser votre Goncourt ! ». Il le tarabuste, le pousse à bout, le traite de tous les noms. L’autre en devient rouge, cramoisi. Et il craque. « Y » lui lance alors une bravade, comme une insulte de gosse : « Et vous alors, qu’est-ce que vous êtes ? ».
Céline exulte : « La première question qu’il me pose ! Ah ! je vais avoir mon interviouwe ! ». Le déballage des pages suivantes est sublime !
Le bouton de col à bascule...
Céline, effectivement, s’engouffre dans la brèche ! « l’émotion du langage parlé à travers l’écrit [..] Une toute petite invention... pratique !... comme le pignon double pour vélo... ». Voilà qui il est Céline ; un petit inventeur. C’est ce qu’il assène à Y. Une petite invention de rien du tout. « La nature ne donne, croyez-moi que très rarissimement la faculté inventive à un homme ». Et Y de déclarer que d’accord pour l’émotion et les inventions mais que les autres écrivains : « ... ils vont jamais en prison ! eux ! ils se tiennent très convenablement ! eux ! ».
Et Céline, dans son élan : « Y a guère que deux espèces d’hommes, où que ce soit, dans quoi que ce soit, les travailleurs et les maquereaux... [...] et les inventeurs sont les pires espèces de « boulots » ! »
« Y » n’a pas l’air de comprendre et puis « c’est pas très intéressant » pour son interview tout ce bla-bla.
En plus, « Y » ne prend pas de notes. Ils perdent leur temps sur ce banc. Céline avance donc au pas de charge et fait le clown pour l’intéresser. Qu’est-ce qui l’intéresse Y, au fait ? Céline le presse. Le professeur pose alors des questions : « Parlez-moi de M. Gallimard... est-il avare comme on le prétend ? » ou bien : « Que pensez-vous d’Aristophane ? », ou encore : « vous admettez que dans l’interviouwe je vous dépeigne nettement maniaque ? obsédé par les petits trucs ? ». Abjecte et convenu, parimatchique !. « Un véritable clancul », un ramolli ! un vrai faux cul, voir un parfait cynique ! « Y » se dresse : « Vous m’insultez ? ». Il s’offusque. Il veut déguerpire ! Céline le retient ; « ce turf d’en trouver un autre ! peut-être encore plus imbécile !... »
Il le rassied et pour le tenir tranquille, lui déclare qu’il va lui confier, en pleine confiance, des vérités essentielles ; des révélations ! La première : c’est que le monde est paranoïaque, atteint de folie présomptueuse... Tout y passe encore une fois ; le monde des Lettres françaises d’abord (surtout); les Académies, les écrivains stipendiés, lèche-bottes, complaisants, complices, nobélisés, le public animal, débile mental, puis la peinture, la musique classique, les médias, . « Y » l’interrompt : « Votre genre de folie, nest-ce pas, vous ? c’est la jalousie ? [...] vous êtes grotesque de prétention ; une vanité de paon »...
Ensuite, -nous sommes page 52- un passage intéressant car il fait directement allusion au fait de guerre que l’on a reproché à Céline et qui, en partie, lui valut son exil au Danemark ; la destruction d’un navire anglais ; l’aviso Kingston cornelian, au large de Gibraltar. « Nous lui passâmes par le milieu ! nous le fîmes couler corps et biens ».. Le professeur l’interrompt de nouveau : « Parlez pas si fort ! pas si fort ! » Du coup, il veut en revenir à Céline l’inventeur. Celui-ci n’est on ne peut plus clair ; les autres écrivains? « ...ils trichent !...ils font semblant d’être détachés... oh ! pas du tout ! jouisseurs porcs ou mantes religieuses !... pharisiens profiteurs de tout ».
Le dépit est immense ! Il crie ensuite qu’on l’a volé, plagié, calomnié. « Y », un peu débordé, lui rétorque : « Vous êtes aigri... vous êtes envieux ! ». Il en convient, Céline. « heureusement que les Chinois vont venir... [...] pour en finir ! Pour faire construire le canal la Somme-Yang-tsé-kiang ». Les Chinois ! Le professeur prend encore une fois ses jambes à son cou. Céline le rattrape : « plus de politique ». Il l’invite même à lui poser des questions. La première est la bonne : « Comment vous est venue l’idée de votre soi-disant nouveau style ? ». Le métro, répond Céline, par le métro !
« Y » est ébaubi, bouché ! Et en plus, il veut pisser ! Céline propose de lui faire un « touché »... plus tard. L’autre croit qu’il plaisante. Pour l’instant, pas question de partir. Céline se livre alors à un développement fulgurant de sa métaphore du métro ; du style rendu émotif, des rails émotifs ! Son style contre tous les autres ! L’accident de Blaise Pascal sur le pont de Neuilly ! Des pages virtuoses ; du grand art, même pour ceux qui le détestent ; une construction dramatique burlesque et millimétrée ; des métaphores puissantes qui laissent entrevoir toute sa profondeur philosophique, lui qui nie être philosophe ou poète, un texte construit et haletant.
Pascal dans sa « deux chevaux » ; tous le monde embarqué dans le métro en question; flics, vélos, croisements, déviations, toutes les distractions de la surface, les midinettes, le postère des dames, le cinéma... « les ponts avec ? » demande Y, décidément indécrotable. Oui. Les ponts avec ! Il se pisse finalement dessus Y. « les nourrices, les kiosques à journaux, les scooters, les messieurs galants, des brigades entières de flics, les terrasses entières de plagiaires... », tout y passe, tout pour l’avaleur des fatigués ! Le professeur perd pied ! Quoi ? Les trois points, les rails émotifs, le cinéma qui ne vaut plus rien ! Et puis... Et puis... « Y » craque. Il surrsaute dans sa flaque d’urine : « Fouchtra ! fouchtri ! tonnerre ! bigre ! bougre ! ». C’en est fini du professeur ! Les voilà entourés de badauds. Céline a beau expliquer, réexpliquer qu’il est un génie, « Y » a perdu l’esprit... Il faut qu’il le ramène chez lui. C’est foutu pour l’interviouve. Les voilà qui traversent Paris !! Le premier en guenille, malingre ; l’autre qui se jette nu dans les bassins jets d’eau ! Qui veut boire ! Se désaltérer ! boire pour faire couler les poignées de sel jetées par Céline dans son gosier de bête ! Comprenne qui pourra !
Prouver qu’on n’a rien à prouver...
Avant d’écrire sur Céline, on fait attention. Plus du tout pour les mêmes raisons qu’avant... mais quand même. On fouille un peu sur le Net, pour voir (parce que les encyclopédies et la faculté ne décollent guère du style et son génie, -l’inverse aussi est béni sous toutes les coutures. Son style nous est avancé comme croûte à ronger, en somme, indéfiniment ! Du Rabelais, une jouvence, le discours de la place publique dans la littérature. Rien de faux, tout le monde en convient, mais rien d’intéressant non plus. Rien de bien dangereux. Céline traité à l’aromathérapie ! Styliste ! De quoi énerver son homme. Surtout après lecture du texte, un texte hérissé, rythmé, profond, carnassier, captivant ; d’une formidable vigueur. Cinquante ans après, pas une ride.
Entretiens avec le professeur Y, un texte d’altitude ; pourquoi ? Le style. Oui. Le Bouleverseur des Lettres Françaises. Mais encore? La petite invention du crawl? Les mantes religieuses, le microcéphale bordelais (quel fou rire!), les Gaston de toutes les espèces qui sont des hommes très riches ? oui encore. La Télévice? L’argot? “il a son rôle, oui!... Certes!... l’histoire de tous les piments!... y en a pas?... votre brouet est con!... y en a trop?... encore plus con!... il y faut un tact!... ” .
Le “je” complétement fétide? “Vous pouvez le dire ! le “moi” coûte énormément cher!... l’outil le plus coûteux qu’il soit ! surtout rigolo!... le “je” ne ménage pas son homme ! surtout lyrique drôle !".
Céline à cache-cache, encore et toujours. On accroche, on le suit, on se marre, avec lui, on pousse nous aussi notre petite bille anar. Petit à petit, il nous fait rompre avec tout, avec le respect, la soumission, le monde des conventions, Céline bouddhiste!, Céline révolutionnaire! Caustique ! hâbleur ! Exib ! Nous sommes avec lui. Réhabilité Céline! Il en a donc un? un côté? Lui l’éternel fuyard? L’inclassable? Le pourri ? On pourrait donc être pleinement avec lui, sans avoir à lui reprocher ses saloperies, l’aimer tout simplement comme on aime Balzac, Chinasky, Stendhal, Proust ? Vous le teniez ? Casé, chosifié, en paix? Et voilà qu’il devient soudainement abjecte, raciste, nationaliste, …iste ! La morsure est vive. Vous lâchez prise, saisi par un frisson de dégoût, un tentacule immonde se rétracte et disparaît dans les ténèbres. Le voilà qui sourit. Est-il vraiment sérieux ?
Quel est le personnage le plus important dans un cirque ? Le clown, pardi. Savez-vous pourquoi ? Parce qu’il sait tout faire ! La plaisanterie est-elle terminée ? Céline tout comme Nietzsche et Sade ont une inquiétante, une monstrueuse vertu... On ne peut rien partager avec eux. Les amadouer, reprendre leur étendard ? Vous vous fourvoyez. Cette ambivalence qu’on leur envie férocement n’a, paradoxalement, rien d’anti-naturel. Tous ces errements topographiques, non seulement du corps mais de la philosophie la plus escarpée, nous renvoient au grand vice de l’humanité : à sa passion pour la cruauté, la douleur infinie du prochain. Nietzsche ne voyait-il pas dans Don Quichote et dans toutes les oeuvres maîtresses du vieil Occident, ce rire grotesque enraciné dans le supplice d’autrui ?
Une conclusion... ?
Cette dernière partie de l’ouvrage est du grand guignol ! Céline et son intervieweur en équipée sauvage dans Paris. La débâcle ! l’Apocalypse oui, mais inversé! Rabelais encore ! Tout n’est vraiment clair que dans cet état de déliquescense et d’inversement des valeurs, de la réalité, des sentiments ! Sa trilogie allemande est basée là-dessus ! la catharsis du jet de tomate ! La dérision la plus cinglante du grand Tout ! La nature humaine là, sous les projecteurs, une photo instantanée d’un mouvement invisible à l’oeil nu ! Ou tout est livré, sans fard, horrible et burlesque ! Lui, bien sûr, n’est jamais sur la touche. Jamais observateur. Toujours acteur. Le vrai courage. Jusqu’au cou. Se déclarer génial ; tout jeter au feu ; voilà qui est à prendre avec une certaine ironie, mais au-delà, c’est se salir, fuir le cliché de l’écrivain immaculé faiseur de leçon ; une sorte de pudeur en fait que de se déclarer, de beugler comme ça que l’on est le premier, le plus grand, le génie définitif ! Une façon de retrouver l’enseignement de cette métaphore de Flaubert (elle vaut ce qu’elle vaut) qui recommandait à l’auteur d’être dans son oeuvre comme Dieu dans la création. Céline y est arrivé ! Là où Proust a échoué.
Le moi de Céline est cosmique ! Voilà ce qui, au-delà du style, reste unique chez lui. Voilà ce qui restera comme une leçon de littérature et de philosophie dans la longue histoire des Lettres ; voilà pourquoi il trône avec Rabelais sur les cimes de l’inversion des valeurs et de l’ambivalence universelle.
Mais redescendons une dernière fois dans les miasmes des boulevards parisiens. Il est tard ; Céline a laissé son interviewer chez lui. Il repart à pied dans la nuit... Et l’interviewe ? Il va la réécrire... « L’essentiel ! l’essentiel ! que je me perde pas ! ». Ils signeront tous les deux ; Y et lui. Voilà tout. Ça passera bien auprès de Gaston et des autres... Après tout, c’est pas si important... « je le dis ! ce n’est pas de telle importance... »
Londres, le 5 avril 2006
Ce texte a été publié auparavant sur le site Le-mort-qui-trompe
Pour en savoir plus sur Céline.
Friday, July 14, 2006
Guerre d'Algérie
"La question" de Henri Alleg. Publié aux éditions de Minuit en 1961 .
Le premier livre sur la torture en Algérie publié en France !

« La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française... » (loi du 23 février 2005, article 1)
L’enthousiasme du gouvernement quant au rôle de la France dans ses colonies n’a semble-t-il pas été compris par tout le monde... Mais ce texte de loi ambitieux –on s’en serait douté- ne faisait cependant aucune référence à la torture appliquée sans restriction par la France à ses sujets d’outre-mer.
Qu’en est-il ? Aurait-on exagéré son rôle tout au long de cette mission civilisatrice ? Serait-elle une invention de l’anti-France et des intellectuels européens qui s’acharnent depuis une cinquantaine d’années « à renier les divers idéaux de leur culture et qui entretiennent en France un malaise tenace ? » .
Qu’on se rassure, les documents de notre glorieux passé colonial sont nombreux et leurs sources vérifiables tant en France qu’à l’étranger. A en juger par ce qu’ils révèlent, et au grand dam des thuriféraires d’une certaine république, ce que l’Assemblée Nationale a voté le 23 février 2005, n’est ni plus ni moins qu’une loi contre l’Histoire .
On est en droit de s’inquiéter des sursauts nostalgiques d’une droite française ouvertement révisionniste et qui, forte de cette loi, s’est vue rivaliser en abjection avec les pires éléments de la réaction exagonale...
La repentance et l’oubli
Un siècle pour effacer complètement les traces d’une guerre de la mémoire sensible d’une nation… En ce qui concerne l’Algérie, en aurons-nous encore pour 50 ans ? Après un conflit colonial d’une telle ampleur, les actes insensés d’hommes puissants et sans scrupules contribuent encore aujourd’hui à donner aux cent ans hasardés à l’instant un incontestable accent réaliste.
La France pense-t-elle, à l’instar du quai d’Orsay, que nous nous sommes mis les Arabes dans la poche ? S’acheter officiellement une bonne conduite, se promener main dans la main aux Portes du Désert avec les dictateurs maghrébins du jour, les traîner ensuite sur les Champs-Elysées, les présenter comme des démocrates accomplis, récolter dans la presse française une moisson d’analyses optimistes sur notre place dans le monde arabe ; voilà qui a son petit effet sur l’opinion publique déjà très au fait des agissements de ces Messieurs dans le pré carré africain .
Moment rêvé pour ouvrir ou rouvrir le livre de Henri Alleg : « la Question ». Pour tout dire, la préface ne présage rien de bon. Les nouveaux maîtres, pour un peu,
la trouveraient démoralisante et défaitiste, voire même criminelle, antifrançaise et antidémocratique ! Voyez plutôt :
Les faits
Alleg, un Français, directeur d‘Alger Républicain, -interdit en septembre 1955- se voit obligé de passer dans la clandestinité douze mois plus tard. Il est arrêté le 12 juin 1957 par les parachutistes français… Il restera entre leurs mains pendant un mois (c’est le récit de cette détention qu’il fait dans son livre).
Comme lui, des centaines, des milliers de civils sont arrêtés à leur domicile, dans la rue ou sur leur lieu de travail. Aucune charge contre eux n’a été retenue ; on les interne dans des camps (Berrouaghia, Bossuet, Paul-Cazelle, etc.) sur simple décision administrative… « …entassés quinze ou vingt dans des pièces […] où ils dormainent à même le ciment. Ils étaient consatamment dans l’obscurité, des jours, des semaines durant -quelque fois plus de deux mois ». Là, sans avocats et sans droits, ils cessent d’être des humains ; et après bien des traitements barbares, la majorité d’entre eux disparaît. Les tortionnaires, les bourreaux sont désignés de longues dates. Pourtant, ils continuent de servir leur pays en toute impunité. La plupart sont aujourd’hui de pacifiques retraités de la fonction publique et de l’armée.
Quant aux survivants des geôles, ils se heurtaient à des instructions judiciaires qui niaient les faits… Alleg fut du nombre.
L’exergue du premier chapitre : « En attaquant les Français corrompus, c’est la France que je défends », ne laisse aucun doute sur ce qui va suivre. Nous aurons affaire à un témoignage qui se veut sans haine ; digne. Et c’est en effet ce que nous trouvons. « je n’oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplices si je ne savais que cela peut-être utile »…
Ces préambules terminés, nous plongeons sans transition dans l’horreur.
Les préparatifs
A peine arrivé, Alleg voit des « prisonniers jetés à coup de matraque d’un étage à l’autre et qui, hébétés par la torture et les coups, ne savent plus que murmurer en arabe les premières paroles d’une ancienne prière ». Des nuits entières pendant trente jours, il entendra hurler des hommes que l’on torture. Des femmes aussi sont amenées et enfermées dans l’autre aile du bâtiment : Djamila Bouhired, Elyette Loup, Nassima Hablal, Melika Khene, Lucie Coscas, Colette Grégoire et d’autres encore, subiront les viols et le martyre.
C’est l’estomac noué que l’on assiste aux préparatifs de l’interrogatoire. Ce que la scène renferme de choquant est la simplicité avec laquelle la victime doit se prêter au jeu. Alleg se déshabille seul, s’allonge seul, nu sur une planche noire, « souillée et gluante de vomissures ». On l’attache, on lui parle presque courtoisement : « ça va faire mal si vous ne parlez pas ».
On retrouve cette sensation d’irréel dans le film de Pontecorvo, « La bataille d’Alger », quand une trentaine de paras silencieux assistent à la torture d’un civil, interrogé au chalumeau…
Et puis, une barbarie sans nom commence.
Le supplice
Une violence inouie ! Un sadisme qui crève l’âme ! Le supplice d’Alleg rempli une
cinquantaine de pages que l’on passe, -on a honte de l’avouer- haletant, nauséeux ! Un para prend le relais de l’autre. On l’asperge d’eau. On lui branche la pince tantôt sur le sexe, tantôt sur l’oreille, on lui plonge les fils denudés dans la gorge. Le courant soude sa mâchoire. Les tortionnaires s’affairent sur leur homme, scientifiques presque. Au nouveau qui arrive et qui actionne la magnéto : « Par petits coups : tu ralentis puis tu repars... ». Pour échapper à ces chutes brusques et à ces remontées aiguës vers le sommet du supplice, Alleg se frappe la tête contre le sol. « ne cherche pas à t’assomer, tu n’y arriveras pas ! ». Il tient bon. Les paras, un peu surpris puis furieux lui disent : « Tu l’auras voulu ; on va te livrer aux fauves ». Il regarde posée sur le sol, contre le mur une énorme pince entourée de bandelettes de papier. « J’essayais d’imaginer quels nouveaux supplices m’attendaient ». Il n’a pas longtemps à attendre. Le fauve, c’est la grosse Gégène. « je sentis une différence de qualité. Au lieu de morsures aiguës et rapides qui semblaient me déchirer le corps, c’était maintenant une douleur plus large qui s’enfonçait profondément dans tous mes muscles et les tordait plus longuement ». Il ne parle toujours pas. Les paras changent de tactique ; un linge sur la tête, on lui applique le supplice du robinet, l’étouffement ; il défaille mais reste muet… Enfin on le laisse tranquille. Cette première séance aura duré douze heures ! On le jette sur une paillasse couverte de fils barbelé. Des bribes d’anciennes conversations lui traversent l’esprit : « l’organisme ne peut tenir indéfiniment : il arrive un moment ou le coeur lâche. »
Quelques heures après, arraché à son sommeil et on le rebranche brutalement aux électrodes…
Pas moyen de le faire parler. Les paras n’en reviennent pas. Il leur inspire même une certaine admiration… Un dur.
En métropole, pendant ce temps, on parle de son enlèvement. L’opinion publique est alertée. Les autorités françaises en Algérie s’inquiètent un peu de ce remue-ménage. Les séances de torture ne cessent pas pour autant… Les tortionnaires varient les sévices ; l’eau, l’asphixie, les brûlures, les passages à tabac, les simulacres d’exécution, l’intimidation : « Ils avaient torturé Mme Touri (la femme d’un acteur bien connu de radio Alger) devant son mari, pour qu’il parle ». Il est terrorisé à l’idée de voir un jour apparaître sa femme… Il vacille. « Et brusquement, j’entendis des cris terribles. Tout près, sans doute dans la pièce d’en face. Quelqu’un qu’on torturait. Une femme. Je crus reconnaître la voix de Gilberte ». Mais il se trompe ; sa femme est en métropole. Il tient bon.
Et puis, après presque trois semaines de tourment, soumis à dix, quinze heures d’interrogatoire quotidien, il finit par ne plus rien sentir : « ils pouvaient peut-être m’arracher les ongles ; je m’étonnai aussitôt de ne pas en ressentir plus de frayeur et je me rassurai presque à l’idée que les mains n’avaient que dix ongles ». Son corps, ses muscles, son âme ne répondent plus ; les coups, l’électricité sont inefficaces ; les paras sont impuissants… Dans un suprême effort, ils essayent alors le pinthotal. Scène inouie à ne pas rater ! Des médecins font la besogne ! Aura-t-on assez parlé de ces médecins surveillant les interrogatoires... ?
« Vous avez notre parole »...
Le pinthotal a été un échec. On le jette dans sa cellule. La rumeur de l’exécution rôde alors autour de lui. « Il ne vous reste plus qu’à vous suicider », lui dit l’aide de camps du général Massu, le lieutenant Mazza ; envoyé comme ultime espoir, pour lui soutirer l’information convoitée, avant l’inévitable…Ce n’est pas sans lui avoir dévoilé auparavant tout son cynisme : « Cela me fait de la peine de vous voir dans cet état ; vous avez 36 ans ; c’est jeune pour mourir . Vous avez peur qu’on sache que vous avez parlé ? Personne ne le saura et nous vous prendrons sous notre protection. Dites tout ce que vous savez et je vous fait transporter tout de suite à l’infirmerie. Dans huit jours , vous serez en France avec votre femme, vous avez notre parole. Sinons, vous allez disparaître ».
Alleg refuse de parler.
La métropole s’agitait. Une Commission de sauvegarde représentée par le général Zeller fut envoyée dans les centres de détention. Alleg très encombrant, fut « camouflé » dans un autre bâtiment. A partir de ce moment, les tortures cessent. « J’allais mieux et j’arrivais à me lever et à me tenir debout » Les paras se bousculent pour le voir dans sa cellule. Ils appréciaient « en sportif » son refus de parler . Ils le questionnent cette fois en simple gardes-chiourme : « Vous avez déjà été torturé dans la résistance ? ». Un petit blond s’approche : « Vous savez, j’ai assisté à tout, hein ! Mon père m’a parlé des communistes dans la Résistance. Ils meurent mais ils ne disent rien. C’est bien ! ».
L’infirmerie
Et puis on l’emmène à l’infirmerie. Il y pénètre le coeur battant. « J’appréhendais de nouvelles injection de penthotal... ». Mais on le soigne. « De ces soins, je savais que je ne pouvais rien conclure [...] S’ils voulaient me torturer à nouveau, il fallait que je ne soit pas trop affaibli ». Mais ce doute fut remplacé par un autre, plus terrible encore : l’exécution.
Les jours passent. Ses plaies se referment. On le remet en cellule. Le centre de « tri » n’avait pas cessé de fonctionner. Les hurlements des suspects remplirent de nouveau ses nuits. « A l’étage au-dessus, ils torturèrent un homme : un Musulman, assez âgé, semblait-il au son de sa voix. Entre les cris terribles que la torture lui arrachait, il disait, épuisé : « Vive la France ! Vive la France ! ». Sans doute croyait-il calmer ainsi ses bourreaux. »
Et puis un para entre un matin dans sa cellule : « Préparez-vous, nous n’allons pas loin. ». Sa captivité prenait fin.
« On ne fait pas la guerre avec des enfants de coeur »
Pour ceux qui trouverait encore la nécessité de s’en convaincre, la torture est, comme la mort, un des visages de la guerre. La Villa Susini en Algérie ou Abou Ghraib en Irak, ne sont pas des accidents isolés. La torture est une arme utilisée systématiquement sur tous les terrains d’opération et bien mal intentionnés seraient ceux qui voudraient nous persuader du contraire...
En ce qui concerne la France et ses bourreaux, on retrouvera certains des hommes nommés dans le livre d’Alleg au service de « groupes d’intérêts » et d’agences de renseignements de la cinquième république . Quant aux Etats-Unis, les bourreaux de Fallujah continuèrent la besogne commencée en Afghanistan... Leur prochaine destination pourrait parfaitement être le Venezuela ou l’Iran ; ils ne sont pas difficiles.
Une grande entreprise de décivilisation...
Henri Alleg termine son récit par un appel fraternel du peuple algérien aux Français qui ignorent ce que l’on a fait « EN LEUR NOM. »
Ce message de paix et de pardon, d’autant plus édifiant qu’il est présenté après cet âpre récit, sert d’écho au grand texte écrit deAimé Césaire, écrit à la même époque : « Discours sur le colonialisme » .
Un texte qui avant de s’attaquer aux méfaits de la colonisation sur le colonisé, dénonce l’un de ces effets les plus pervers : la décivilisation du colonisateur lui-même en proie à un ensauvegement qui l’abrutit, le dégrade, reveille en lui des instincts enfouis, la convoitise, la violence, la haine raciale, le relativisme moral.. .
A la décolonisation forcée des années 60 succéda un néocolonialisme mercantiliste qui fit long feu et qui dure encore aujourd’hui, rampant sous le masque inoffensif de l’humanitaire. Ces trois expressions des sociétés occidentales ont en commun un paternalisme brutal qui retarde l’avénement de politiques fondées sur le respect des peuples et des cultures.
Londres, le 18 avril 2006
Henry Alleg – Biographie.
Ecrivain et journaliste français né en 1920. Il fut le premier à dénoncer la torture en Algérie dans son livre : « La question » (1957). Ce fut le premier ouvrage à dévoiler au Français l’existence de la torture en Algérie. Ce livre qui commotionna l’opinion publique française a été censuré pendant des années par le gouvernement français.
Alleg était surtout connu en Algérie comme directeur du seul journal anticolonialiste d’Algérie « Alger Républicain » juste avant le début des évènements. En 1965, le voilà de retour en France, devenu persona non grata en Algérie. Membre actif du parti communiste depuis l’âge de 20 ans, il a travaillé pour le quotidien français l’Humanité en métropole puis est devenu son correspondant international.
Le premier livre sur la torture en Algérie publié en France !

« La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française... » (loi du 23 février 2005, article 1)
L’enthousiasme du gouvernement quant au rôle de la France dans ses colonies n’a semble-t-il pas été compris par tout le monde... Mais ce texte de loi ambitieux –on s’en serait douté- ne faisait cependant aucune référence à la torture appliquée sans restriction par la France à ses sujets d’outre-mer.
Qu’en est-il ? Aurait-on exagéré son rôle tout au long de cette mission civilisatrice ? Serait-elle une invention de l’anti-France et des intellectuels européens qui s’acharnent depuis une cinquantaine d’années « à renier les divers idéaux de leur culture et qui entretiennent en France un malaise tenace ? » .
Qu’on se rassure, les documents de notre glorieux passé colonial sont nombreux et leurs sources vérifiables tant en France qu’à l’étranger. A en juger par ce qu’ils révèlent, et au grand dam des thuriféraires d’une certaine république, ce que l’Assemblée Nationale a voté le 23 février 2005, n’est ni plus ni moins qu’une loi contre l’Histoire .
On est en droit de s’inquiéter des sursauts nostalgiques d’une droite française ouvertement révisionniste et qui, forte de cette loi, s’est vue rivaliser en abjection avec les pires éléments de la réaction exagonale...
La repentance et l’oubli
Un siècle pour effacer complètement les traces d’une guerre de la mémoire sensible d’une nation… En ce qui concerne l’Algérie, en aurons-nous encore pour 50 ans ? Après un conflit colonial d’une telle ampleur, les actes insensés d’hommes puissants et sans scrupules contribuent encore aujourd’hui à donner aux cent ans hasardés à l’instant un incontestable accent réaliste.
La France pense-t-elle, à l’instar du quai d’Orsay, que nous nous sommes mis les Arabes dans la poche ? S’acheter officiellement une bonne conduite, se promener main dans la main aux Portes du Désert avec les dictateurs maghrébins du jour, les traîner ensuite sur les Champs-Elysées, les présenter comme des démocrates accomplis, récolter dans la presse française une moisson d’analyses optimistes sur notre place dans le monde arabe ; voilà qui a son petit effet sur l’opinion publique déjà très au fait des agissements de ces Messieurs dans le pré carré africain .
Moment rêvé pour ouvrir ou rouvrir le livre de Henri Alleg : « la Question ». Pour tout dire, la préface ne présage rien de bon. Les nouveaux maîtres, pour un peu,
la trouveraient démoralisante et défaitiste, voire même criminelle, antifrançaise et antidémocratique ! Voyez plutôt :
Les faits
Alleg, un Français, directeur d‘Alger Républicain, -interdit en septembre 1955- se voit obligé de passer dans la clandestinité douze mois plus tard. Il est arrêté le 12 juin 1957 par les parachutistes français… Il restera entre leurs mains pendant un mois (c’est le récit de cette détention qu’il fait dans son livre).
Comme lui, des centaines, des milliers de civils sont arrêtés à leur domicile, dans la rue ou sur leur lieu de travail. Aucune charge contre eux n’a été retenue ; on les interne dans des camps (Berrouaghia, Bossuet, Paul-Cazelle, etc.) sur simple décision administrative… « …entassés quinze ou vingt dans des pièces […] où ils dormainent à même le ciment. Ils étaient consatamment dans l’obscurité, des jours, des semaines durant -quelque fois plus de deux mois ». Là, sans avocats et sans droits, ils cessent d’être des humains ; et après bien des traitements barbares, la majorité d’entre eux disparaît. Les tortionnaires, les bourreaux sont désignés de longues dates. Pourtant, ils continuent de servir leur pays en toute impunité. La plupart sont aujourd’hui de pacifiques retraités de la fonction publique et de l’armée.
Quant aux survivants des geôles, ils se heurtaient à des instructions judiciaires qui niaient les faits… Alleg fut du nombre.
L’exergue du premier chapitre : « En attaquant les Français corrompus, c’est la France que je défends », ne laisse aucun doute sur ce qui va suivre. Nous aurons affaire à un témoignage qui se veut sans haine ; digne. Et c’est en effet ce que nous trouvons. « je n’oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplices si je ne savais que cela peut-être utile »…
Ces préambules terminés, nous plongeons sans transition dans l’horreur.
Les préparatifs
A peine arrivé, Alleg voit des « prisonniers jetés à coup de matraque d’un étage à l’autre et qui, hébétés par la torture et les coups, ne savent plus que murmurer en arabe les premières paroles d’une ancienne prière ». Des nuits entières pendant trente jours, il entendra hurler des hommes que l’on torture. Des femmes aussi sont amenées et enfermées dans l’autre aile du bâtiment : Djamila Bouhired, Elyette Loup, Nassima Hablal, Melika Khene, Lucie Coscas, Colette Grégoire et d’autres encore, subiront les viols et le martyre.
C’est l’estomac noué que l’on assiste aux préparatifs de l’interrogatoire. Ce que la scène renferme de choquant est la simplicité avec laquelle la victime doit se prêter au jeu. Alleg se déshabille seul, s’allonge seul, nu sur une planche noire, « souillée et gluante de vomissures ». On l’attache, on lui parle presque courtoisement : « ça va faire mal si vous ne parlez pas ».
On retrouve cette sensation d’irréel dans le film de Pontecorvo, « La bataille d’Alger », quand une trentaine de paras silencieux assistent à la torture d’un civil, interrogé au chalumeau…
Et puis, une barbarie sans nom commence.
Le supplice
Une violence inouie ! Un sadisme qui crève l’âme ! Le supplice d’Alleg rempli une
cinquantaine de pages que l’on passe, -on a honte de l’avouer- haletant, nauséeux ! Un para prend le relais de l’autre. On l’asperge d’eau. On lui branche la pince tantôt sur le sexe, tantôt sur l’oreille, on lui plonge les fils denudés dans la gorge. Le courant soude sa mâchoire. Les tortionnaires s’affairent sur leur homme, scientifiques presque. Au nouveau qui arrive et qui actionne la magnéto : « Par petits coups : tu ralentis puis tu repars... ». Pour échapper à ces chutes brusques et à ces remontées aiguës vers le sommet du supplice, Alleg se frappe la tête contre le sol. « ne cherche pas à t’assomer, tu n’y arriveras pas ! ». Il tient bon. Les paras, un peu surpris puis furieux lui disent : « Tu l’auras voulu ; on va te livrer aux fauves ». Il regarde posée sur le sol, contre le mur une énorme pince entourée de bandelettes de papier. « J’essayais d’imaginer quels nouveaux supplices m’attendaient ». Il n’a pas longtemps à attendre. Le fauve, c’est la grosse Gégène. « je sentis une différence de qualité. Au lieu de morsures aiguës et rapides qui semblaient me déchirer le corps, c’était maintenant une douleur plus large qui s’enfonçait profondément dans tous mes muscles et les tordait plus longuement ». Il ne parle toujours pas. Les paras changent de tactique ; un linge sur la tête, on lui applique le supplice du robinet, l’étouffement ; il défaille mais reste muet… Enfin on le laisse tranquille. Cette première séance aura duré douze heures ! On le jette sur une paillasse couverte de fils barbelé. Des bribes d’anciennes conversations lui traversent l’esprit : « l’organisme ne peut tenir indéfiniment : il arrive un moment ou le coeur lâche. »
Quelques heures après, arraché à son sommeil et on le rebranche brutalement aux électrodes…
Pas moyen de le faire parler. Les paras n’en reviennent pas. Il leur inspire même une certaine admiration… Un dur.
En métropole, pendant ce temps, on parle de son enlèvement. L’opinion publique est alertée. Les autorités françaises en Algérie s’inquiètent un peu de ce remue-ménage. Les séances de torture ne cessent pas pour autant… Les tortionnaires varient les sévices ; l’eau, l’asphixie, les brûlures, les passages à tabac, les simulacres d’exécution, l’intimidation : « Ils avaient torturé Mme Touri (la femme d’un acteur bien connu de radio Alger) devant son mari, pour qu’il parle ». Il est terrorisé à l’idée de voir un jour apparaître sa femme… Il vacille. « Et brusquement, j’entendis des cris terribles. Tout près, sans doute dans la pièce d’en face. Quelqu’un qu’on torturait. Une femme. Je crus reconnaître la voix de Gilberte ». Mais il se trompe ; sa femme est en métropole. Il tient bon.
Et puis, après presque trois semaines de tourment, soumis à dix, quinze heures d’interrogatoire quotidien, il finit par ne plus rien sentir : « ils pouvaient peut-être m’arracher les ongles ; je m’étonnai aussitôt de ne pas en ressentir plus de frayeur et je me rassurai presque à l’idée que les mains n’avaient que dix ongles ». Son corps, ses muscles, son âme ne répondent plus ; les coups, l’électricité sont inefficaces ; les paras sont impuissants… Dans un suprême effort, ils essayent alors le pinthotal. Scène inouie à ne pas rater ! Des médecins font la besogne ! Aura-t-on assez parlé de ces médecins surveillant les interrogatoires... ?
« Vous avez notre parole »...
Le pinthotal a été un échec. On le jette dans sa cellule. La rumeur de l’exécution rôde alors autour de lui. « Il ne vous reste plus qu’à vous suicider », lui dit l’aide de camps du général Massu, le lieutenant Mazza ; envoyé comme ultime espoir, pour lui soutirer l’information convoitée, avant l’inévitable…Ce n’est pas sans lui avoir dévoilé auparavant tout son cynisme : « Cela me fait de la peine de vous voir dans cet état ; vous avez 36 ans ; c’est jeune pour mourir . Vous avez peur qu’on sache que vous avez parlé ? Personne ne le saura et nous vous prendrons sous notre protection. Dites tout ce que vous savez et je vous fait transporter tout de suite à l’infirmerie. Dans huit jours , vous serez en France avec votre femme, vous avez notre parole. Sinons, vous allez disparaître ».
Alleg refuse de parler.
La métropole s’agitait. Une Commission de sauvegarde représentée par le général Zeller fut envoyée dans les centres de détention. Alleg très encombrant, fut « camouflé » dans un autre bâtiment. A partir de ce moment, les tortures cessent. « J’allais mieux et j’arrivais à me lever et à me tenir debout » Les paras se bousculent pour le voir dans sa cellule. Ils appréciaient « en sportif » son refus de parler . Ils le questionnent cette fois en simple gardes-chiourme : « Vous avez déjà été torturé dans la résistance ? ». Un petit blond s’approche : « Vous savez, j’ai assisté à tout, hein ! Mon père m’a parlé des communistes dans la Résistance. Ils meurent mais ils ne disent rien. C’est bien ! ».
L’infirmerie
Et puis on l’emmène à l’infirmerie. Il y pénètre le coeur battant. « J’appréhendais de nouvelles injection de penthotal... ». Mais on le soigne. « De ces soins, je savais que je ne pouvais rien conclure [...] S’ils voulaient me torturer à nouveau, il fallait que je ne soit pas trop affaibli ». Mais ce doute fut remplacé par un autre, plus terrible encore : l’exécution.
Les jours passent. Ses plaies se referment. On le remet en cellule. Le centre de « tri » n’avait pas cessé de fonctionner. Les hurlements des suspects remplirent de nouveau ses nuits. « A l’étage au-dessus, ils torturèrent un homme : un Musulman, assez âgé, semblait-il au son de sa voix. Entre les cris terribles que la torture lui arrachait, il disait, épuisé : « Vive la France ! Vive la France ! ». Sans doute croyait-il calmer ainsi ses bourreaux. »
Et puis un para entre un matin dans sa cellule : « Préparez-vous, nous n’allons pas loin. ». Sa captivité prenait fin.
« On ne fait pas la guerre avec des enfants de coeur »
Pour ceux qui trouverait encore la nécessité de s’en convaincre, la torture est, comme la mort, un des visages de la guerre. La Villa Susini en Algérie ou Abou Ghraib en Irak, ne sont pas des accidents isolés. La torture est une arme utilisée systématiquement sur tous les terrains d’opération et bien mal intentionnés seraient ceux qui voudraient nous persuader du contraire...
En ce qui concerne la France et ses bourreaux, on retrouvera certains des hommes nommés dans le livre d’Alleg au service de « groupes d’intérêts » et d’agences de renseignements de la cinquième république . Quant aux Etats-Unis, les bourreaux de Fallujah continuèrent la besogne commencée en Afghanistan... Leur prochaine destination pourrait parfaitement être le Venezuela ou l’Iran ; ils ne sont pas difficiles.
Une grande entreprise de décivilisation...
Henri Alleg termine son récit par un appel fraternel du peuple algérien aux Français qui ignorent ce que l’on a fait « EN LEUR NOM. »
Ce message de paix et de pardon, d’autant plus édifiant qu’il est présenté après cet âpre récit, sert d’écho au grand texte écrit deAimé Césaire, écrit à la même époque : « Discours sur le colonialisme » .
Un texte qui avant de s’attaquer aux méfaits de la colonisation sur le colonisé, dénonce l’un de ces effets les plus pervers : la décivilisation du colonisateur lui-même en proie à un ensauvegement qui l’abrutit, le dégrade, reveille en lui des instincts enfouis, la convoitise, la violence, la haine raciale, le relativisme moral.. .
A la décolonisation forcée des années 60 succéda un néocolonialisme mercantiliste qui fit long feu et qui dure encore aujourd’hui, rampant sous le masque inoffensif de l’humanitaire. Ces trois expressions des sociétés occidentales ont en commun un paternalisme brutal qui retarde l’avénement de politiques fondées sur le respect des peuples et des cultures.
Londres, le 18 avril 2006
Henry Alleg – Biographie.
Ecrivain et journaliste français né en 1920. Il fut le premier à dénoncer la torture en Algérie dans son livre : « La question » (1957). Ce fut le premier ouvrage à dévoiler au Français l’existence de la torture en Algérie. Ce livre qui commotionna l’opinion publique française a été censuré pendant des années par le gouvernement français.
Alleg était surtout connu en Algérie comme directeur du seul journal anticolonialiste d’Algérie « Alger Républicain » juste avant le début des évènements. En 1965, le voilà de retour en France, devenu persona non grata en Algérie. Membre actif du parti communiste depuis l’âge de 20 ans, il a travaillé pour le quotidien français l’Humanité en métropole puis est devenu son correspondant international.
Talleyrand

L’art de la biographie est un vaste domaine où même les plus moins doués peuvent trouver leur chemin mais rares sont les occasions de lire un ouvrage assez bon pour nous pousser à réfléchir sur la nature réelle d’un tel art.
Une biographie a évidemment ceci de risqué qu’elle nous montre un esprit de premier ordre, un homme ou une femme exceptionnels à bien des égards, un être dont le destin s’est confondu avec celui de son siècle. Le biographe chargé de mettre en scène ce personnage, s’érige en juge et ne peut faire autrement que de le suivre sur quelques pages. La métaphore de Flaubert comparant Dieu et l’écrivain dans leurs œuvres respectives est inopérante pour le genre biographique (le contraire est même souhaitable, nous verrons pourquoi). Quoi que fasse le biographe, il est partout et on le voit. Sa présence se fait sentir au fil des pages ; il est derrière chaque mot, derrière chaque idée et les bribes de mémoire qu’il restitue à l’Histoire sont empruntes de sa volonté. D’une façon générale, son ombre apparaît au-dessus de l’édifice biographique qu’il a construit.. Si son travail se trouve être médiocre, le lecteur subit le specatcle de sa minable carrure et le supporte comme un mauvais compagnon de voyage. S’il est tout le contraire, son aventure au coeur de la problématique biographique laisse un témoignage passionnant à l’image, par exemple, du travail que nous a livré Duff Cooper dans son Talleyrand.
Mais rassurons-nous –et là s’explique peut-être l’indulgence à l’égard du biographe timorée et sans brio-, il est bien rare de ne rien pouvoir sauver d’un ouvrage s’inspirant de l’histoire. Bien que la médiocrité et l’audace fassent souvent la paire sur les grands chemins du monde littéraire, le genre biographique est rarement decevant au point d’en arrêter la lecture d’un ouvrage. Qu’il s’agisse d’un universitaire ennuyeux et veule, d’un érudit froid et sans imagination, d’un dilettante vaniteux ou d’un écrivassier rancunier, le lecteur s’en lasse rapidement et feint de l’ignorer après quelques chapitres. Tout le trouble s’arrête là. Le vrai biographe, quant à lui, est reconnu comme un « bon commis » -on ne lui en demande pas plus-, doué d’un esprit pratique et sain qui, au-delà de la quête du remarquable cherche sincèrement dans l’âme et les actes de son sujet les traces de dieu et de l’éternité dans l’homme. Les vrais biographes prennent ce risque ; les autres n’ont que les dates et les faits.
De grands ouvrages tels le « Balzac » de Stéphan Sweig, le « Saint Just » de Pierre Ollivier et le « Talleyrand » de Duff Cooper, réunissent toutes les conditions d’amour et d’empathie nécessaires à une communion sans faille. Tous furent écrits par des hommes ambiteux et courageux qui ne songeaient pas à plaire ou faire des pièces monumentales enrobées de stuc. Car c’est là un des secrets de la bonne biographie ; ne jamais tenter de saisir au premier abord le personnage dans son ensemble ; bâtir plutôt son histoire autour d’un ou deux conflits extrêmes qui le suivront jusque dans la tombe, retrouver ses circonstances à chaque étape de sa vie, définir ses ambitions pour ainsi retrouver sous le marbre la chair palpitante, l’humanité brisée par le mythe !
Sweig avait cet immense pouvoir de saisir l’humain dans l’homme d’exception, de pénétrer son caractère au point d’y voir clairement ses points de grande densité et partant de là, de déterminer les moments cruciaux de son existence, moments qui ne sont pas toujours en accord avec le calendrier officiel. Seul Sweig a vu que le jeune Balzac était un « lent », un esprit qui avait mûri plus lentement que celui de ses camarades et qui avait mis un temps fou à rassembler ses forces. Son professeur de Lettres, après la lecture de son Cromwell, n’avait-il pas dit à sa mère qu’il n’avait absolument rien à faire en littérature ? Sweig a eu l’audace, que personne jusqu’ici ne lui a contestée, d’expliquer la naissance du jeune génie qui s’ignorait encore par la conquête d’une femme, Laure de Bernie, de vingt cinq ans son aînée ! Sweig montre des surhommes en lutte contre le monde et contre eux-mêmes.
Ollivier, moins sensuel et peut-être plus prosaïque, ose cependant se jeter dans la Révolution et la Terreur, se frotte et coudoie des êtres aussi contradictoires, insaisissables et déterminés que Robespierre, Marat, Collot-d’Herbois, etc. Il s’est efforcé de recréer pour le lecteur l’atmosphère électrisante qui régnait à l’époque, dans cette France des Etat Généraux et de la Constituante puis de 93 et de la Terreur. Il analyse tous les évènements avec perspicacité et intelligence et les resitue dans leur contexte. Il s’approche si près de Robespierre qu’il finit par découvrir sa jalousie envers le jeune Saint Just à qui il attribue les véritables qualités d’un révolutionnaire. Un Saint Just surdoué et poète frustré qui eut un mal fou à trouver sa vocation et qui se jeta dans les bras de la révolution naissante, conscient qu’elle le perdrait et lui donnerait la gloire. Sous la plume d’Ollivier, il n’est plus l’homosexuel poudré, maçon et pervers dépeint par le très réactionnaire Abel Gance dans son film Napoléon… Un portrait de la Révolution qui a pourtant fait long feu dans les rangs de la démocratie bourgeoise de la troisième république.
Duff Cooper (1890-1954) quant à lui, est un homme politique et un diplomate anglais qui dans le premier tiers du XXe siecle a connu une certaine notoriété dans son pays. Tout comme Talleyrand , il a été jusqu’au bout fidèle à ses principes et démissionne, par exemple, en 1938 après les accords de Munich signés par Chamberlain. Il reviendra au pouvoir en 1941 comme ministre de l’information de Winston Churchill puis sera nommé ambassadeur en France après la guerre.
Des trois remarquables biographies citées jusqu’ici, c’est sans doute celle qui remporte la palme de la subjectivité. Cooper est en effet incapable de cacher sa fascination pour Talleyrand, parangon, selon lui, du diplomate à la fois géopoliticien visionnaire et précurseur de l’idée d’une Europe unie dans la paix et le commerce, une Europe qui, coûte que coûte, devait renoncer à
ses luttes intérieures pour s’unir et stabiliser le monde.
Cooper s’attaque à un personnage méconnu et méprisé dans sa patrie d’origine, esprit colossal et insaisissable qui a defrayé la chronique de son temps –« l’évêque apostat ».
Hâtivement jugé en France en raison de ses mœurs corrompues tant sur le plan personnel que politique, son activité et ses victoires diplomatiques ont été systématiquement sous estimées voire méprisées. Accusé de trahison par la postérité, il n’est resté dans la mémoires des Français qu’un libertin boiteux doué d’une rare ironie et le père supposé de Delacroix. Mais comme le fait remarquer Cooper, son image dans les siècles dépendra toujours de la brillance de celle de Napoléon. Car le destin de ces deux hommes a été intimement lié. Sur bien des plans, on peut considérer Talleyrand comme le mentor du jeune Bonaparte qui cherchait des appuis à Paris sous le Directoire. En effet, en 1797, Talleyrand décroche le portefeuille des Relations Extérieures. La France en état de guerre est prodigieusement énergique -c’est le triomphe de la bourgeoisie- même si le pays est dans un état pitoyable. L’époque est corrompue. La guerre est pour toute une classe le moyen de s’enrichir. On peut passer du ruisseau à l’opulence en six mois. Talleyrand, miraculé de l’Ancien Régime, amasse son immense fortune à cette époque. « Ses compétences reconnues lui ont valu un poste important au sein d’un gouvernement faible et déjà condamné » . Il sent le vent tourner et cherche autour de lui les hommes susceptibles de jouer un rôle dans les changements qui s’annoncent. « Avant la fin de sa première semaine au ministère, il écrit au jeune général qui conduit l’armée d’Italie, Napoléon Bonaparte, qu’il n’a jamais vu, pour l’assurer dans les termes les plus flagorneurs de son admiration et de son respect. Bonaparte répond et une correspondance s’instaure. Le jeune général comprend vite que le soutien et
les conseils de cet homme-là lui seront précieux » . Les voilà bientôt réunis à Paris où ils complotent activement à la perte du régime en place. Ces quelques mois de réunions secrêtes feront la fortune et la gloire de Talleyrand dans les années qui suivront. Sous le Consulat, Bonaparte, jeune encore, il a juste trente ans, a d’ailleurs besoin de cet homme d’état chevronné qui a survécu à la Révolution et à la Terreur. M. Bourrienne, son vieux condisciple et secrétaire particulier en témoigne : « il recevait toujours avec plaisir la visite de M. de Talleyrand. J’ai souvent assisté aux conférences de ce grand homme d’état avec le premier consul, et je dois à la vérité de déclarer que jamais je ne l’ai vu le flatter dans ses rêves d’ambition, qu’au contraire il s’efforca toujours de le diriger dans le sens de ses véritables intérêts ». Ce témoignage renferme ce qui poussera Talleyrand à trahir Napoléon quelques années plus tard. La différence fondamentale entre les deux hommes est leur tempéramment. Talleyrand est dévoué à la grandeur de la France, patient et même nonchalent au moment de traiter les affaires les plus graves. De nombreuses personnes s’en effraieront. Napoléon, au contraire, est décrit comme un arrogant qui ne voit que le bien et la prospérité de sa propre dynastie. Talleyrand lui reprochera cet aveuglement sans borne et sa façon impitoyable de traiter les vaincus dans une Europe condamnée à fraterniser tôt ou tard. Le premier est un renard, l’autre un lion.
Talleyrand mourra après Louis XVIII, sous le règne de Louis Philippe –
qui se deplacera d‘ailleurs à son chevet- couvert de gloire et respecté par toutes les couronnes d’Europe. Napoléon perdra tout à peu près 15 ans plus tard et mourra sur un rocher…
Sur son lit de mort, Talleyrand, lucide jusqu’au bout, sait bien que son étoile s’éteindrait dans les siècles si celle de Napoléon venait à briller à nouveau. Il eut raison ; une fois de plus.
Cooper réhabilite donc ce « grand méconnu » en 1932, date de la sortie de l’ouvrage en Angleterre. Il est présenté comme un anglophile à outrance qui vénérait la constitution anglaise dont il s’était si fortement inspiré en 1789.
Cooper, futur ambassadeur, est fasciné par le charismatique Prince de Talleyrand, représentant de la vieille noblesse française, grand charmeur, exquis, spirituel, séducteur impénitent, « Maître des diplomates », corrompu et corrupteur qui, contrairement à ce que l’on peut croire, situait sa science de la persuasion aux antipodes de la duplicité et de la tromperie. Science qui donna ses fruits et sauva de l’humiliation la France vaincue lors du Congrès de Vienne en 1814 après la débâcle napoléonienne. A lire absolument, ce chapitre intitulé « le Congrès de Vienne » qui décrit avec maestria l’atmosphère de la Restauration et très en détail le travail colossal accomplit par le Talleyrand.
Cooper connaît son sujet à merveille et c’est un des attraits de cette biographie dont la structure est, au premier abord, des plus banales, puisqu’elle suit religieusement la chronologie des événements ; débutant avec les Etats Généraux, auxquels succèdent la Constituante, la Terreur, le Directoire, le 18 brumaire, le Consulat, l’Empire, la Première Restauration, les 100 jours, la Seconde Restauration, etc. Exception faite de la Terreur et de son séjour en Amérique -chapitre le plus ennuyant du livre ; heureusement le plus court-, notre homme est dans tous les gouvernements depuis 89 ! Voilà qui justifie un plan en apparence si banal ! Voilà qui donne du même coup une trame romanesque à cette vie exceptionnelle! On finit par aimer ce saltimbanque distingué et cynique ! On admire son instint de survie et son intelligence hors du commun ! Grande réussite de la part de Cooper de nous faire aimer un être hautain et méprisant qui aujourd’hui seraient la pâture de la presse et des juges.
Ce « Talleyrand » est un ouvrage indispensable qui se lit comme un roman d’aventure, dans le sens le plus noble du terme. Vous rirez aux éclats avec les bons mots du maître, vous serez captivés par les intrigues de cour et les révélations ! Et quelles révélations ! La moins importante historiquement se trouve être néanmoins la plus cocasse :
« Sur ce, Napoléon se tourne vers Talleyrand qui est adossé à la cheminée dans une attitude typique, gracieuse et négligente. Pendant une demi-heure de temps, sans interruption, à jet continu, l’Empereur incendie Talleyrand. Il est accusé de tous les crimes : voleur, lâche, traître. Il a manqué toute sa vie à tous ses devoirs, il a trompé tout le monde, il ne croit pas en Dieu et il vendrait son propre père. Exaspéré par l’impassibilité de Talleyrand, le Corse perd son self-control, raille son infirmité et lui jette à la figure les infidélités de son épouse. Finalement brandissant son poing serré, il semble sur le point de le frapper. Mais il se contente de lancer à son vice grand électeur qu’il n’est que « de la merde dans un bas de soie ».
Les témoins de cette scène sont horrifiés. Le comportement de l’Empereur vaudrait un savon à n’importe quel officier qui traiterait un soldat de la sorte. Tous les témoignages concordent cependant sur un point : le seul qui dans cette pièce semble parfaitement indifférent à l’éclat, c’est sa cible, Talleyrand. Il n’a pas changé d’attitude, n’a pas rougi, n’a pas cillé. Comme si Napoléon ne s’adressait pas à lui.
Après cette tirade, Napoléon renvoie tout le monde. Talleyrand se dirige lentement vers la porte en claudiquant. Soudain, il se tourne vers l’un de ceux qui ont assisté à son épreuve et lance calmement : « Quel dommage qu’un si grand homme soit si mal élevé ! »
Tout serait parfait dans cet ouvrage si l’auteur ne s’était laissé emporter par un instinct de classe –à n’en pas douter, le sien- qui va parfois jusqu'à l’outrance. Nous avons en face de nous un homme d’état doublé d’un bon écrivain. Redoutable mélange quand le second est au service du premier. La France nous en a donné de bons exemples avec Hugo et Lamartine. Quant à Chateaubriant (il avait Talleyrand en aversion), Cooper règle ses comptes avec lui, l’accusant notamment d’avoir travesti l’histoire dans ses mémoires d’outre-tombe…
Si Cooper néglige l’aspect éthique des événements traités, c’est sans aucun doute -nous le savons depuis Macchiavel- par cette terrible nécessité du « milieu politique » de traiter les évènements par le haut sans jamais se soucier des êtres broyés par la raison d’état. Ouvrage politique donc que ce « Talleyrand », qui ne laisse pas le choix des armes au lecteur. L’esprit macchiavélique, dans le sens littéral du mot, dont fait preuve Cooper est ici posé en axiome et la charpente admirablement travaillée de l’ouvrage voudrait nous faire croire à « l’inéluctabilité » des causes et des effets qui contribuèrent à faire la fortune et la gloire de Talleyrand. Cette connivence qu’il instaure avec le lecteur -connivence forcée, nous le répétons-, est un acte en faveur de la philosophie « conservatrice » de l’auteur. Un « conservatisme » illustré, nous n’en doutons pas, qui cache mal cependant ses tendances monarchistes. Un cocktail trop anglais pour le républicanisme de la troisième république, d’autant plus irritant qu’il a tendance à minimiser la personnalité de Napoléon, traité ici comme un ambitieux instable et insatiable. Voila qui expliquerait en partie la courte carrière de l’ouvrage en France.
Au delà des récriminations politiques, l’ouvrage reste cependant un morceau de choix tant ses qualités sont nombreuses, la plus remarquable étant la réhabilitation d’un immense homme d’état doublé d’une personnalité hors du commun.
Londres, le 4 avril 2006
Le titre de l'ouvrage: "Talleyrand, un seul maître : La France"
Auteur: Duff Cooper
Editeur: Editions Alvik
Subscribe to:
Posts (Atom)